|
Présentation |
|
|
Ligue de Croche
Disciplines à la loupe
La Croche en détail
| |
| | |
|
Rencontre avec... |
|
|
  Les compétiteurs Les compétiteurs
  Les professeurs Les professeurs
| |
| | |
|
| Nouvelles | |
|
REQUETE
- par Jeronimo
le 04/06/2008 @ 08:44 J'invite chaleureusement tous les participants (compétiteurs, entraîneurs, spectateurs) des championnats de la Réunion de croche 2008 à laisser leurs impressions, critiques et/ou conseils sur le forum. Ce n'était que la première saision et il y a sans doute BEAUCOUP de choses à améliorer. Nous comptons sur VOUS pour nous dire comment évoluer dans le bon sens ! Jérôme Sanchez (organisateur des championnats et arbitre de croche)
Premières photos des championnats de la Réunion de croche 2008
- par Jeronimo
le 02/06/2008 @ 20:58 Pendant des décennies (c'est-à-dire depuis les années 1970), la croche était dans le fénoir. 
Mais sa renaissance a enfin eu lieu, ce dimanche 1er juin 2008 dans la salle d'arts martiaux de l'Etang Saint-Paul.  L'aire de combat est désormais un tapis de lutte olympique. 
Les arbitres (ici Jérôme Sanchez) sont reconnaissables à leur polo blanc orné du logo de la croche. 
Progressivement, les compétiteurs devront porter la tenue moulante : lycra rouge ou bleu selon le coin (symboliquement : le rouge du volcan réunionnais, le Piton de la Fournaise, et le bleu de l'océan Indien) et short cycliste noir (symboliquement : le basalte dont est faite l'île de la Réunion). 
Le comptage des points est simple : 1 point pour les projections (2 pour celles de grande amplitude) et 1 point pour les immobilisations ou positions de contrôle tenues 3 secondes. L'arbitre indique aux juges de table les points marqués par le bleu ou le rouge, et ceux-ci valident ou pas en affichant le score sur le tableau de marquage. 
Pour la sécurité des combattants, un deuxième arbitre veille aux sorties éventuelles du tapis et aux clés articulaires qui pourraient échapper à un seul arbitre. 
Les entraîneurs ont été très présents lors des championnats (ici Dominique Prix, combattant professionel de MMA, dont le club a terminé troisième des championnats). 
Les cadres du Comité de Lutte de la Réunion également (ici José Puylaurent, président de la commission grappling au sein du Comité, par ailleurs entraîneur du club Fleurimont 1 Top Team). 
Les combats nous ont permis d'assiter à de la lutte debout (dans un style très proche de la lutte libre olympique) 
Avec de belles projections (comme ici un hanché réussi par le judoka-samboïste Boris Gamel contre le lutteur Johny Adelin, en finale des 84kg) 
L'action s'est également souvent déroulée au sol (comme en grappling) ... 
... avec tantôt beaucoup de dynamisme (ici Aurélien Fosse du "free fight" face à Jérôme Mussard du "sambo combat" de Saint-André) ... 
... tantôt avec des compressions et/ou des clés articulaires (ici Jean-Pierre Tarley, 106kg, entraîneur du club de croche de Bois de Nèfles). 
Les compétiteurs ont été très concentrés (ici Lionel Sanchez dit "Le Taureau du Bosphore", finaliste des 96kg) ... 
... tout en gardant un excellent esprit (à l'image du roi des 96kg, Yves "Charlie" Preira, exemplaire de sportivité). 
La catégorie des poids lourds nous a permis d'assister au retour triomphal d'Emmanuel Sénardière (ici face au judoka-samboïste Alexandre Hoarau), vainqueur des Jeux des Îles de l'Océan Indien en lutte libre, chez les 120kg. 
La journée s'est terminée par la grande finale des 74kg sous l'oeil de Giovany Sorlier, vainqueur du Tournoi Régional de Grappling, et des nombreux spectateurs présents. 
Les excellents Aurélien Fosse (du Club Sportif et Culturel Cité Hyacinthe - Free Fight) et David Vidot (du Run Kyokushin Honbu - Sambo, entraîné par Bertrand Boucher) se sont livrés à un duel extrêmement serré ... qui s'est hélas conclu par une décision litigieuse. Un ultime point accordé par l'arbitre en bordure du tapis à la dernière seconde du combat donne la victoire 4 à 3 à Aurélien Fosse et prive les spectateurs d'une prolongation. Voilà en tout cas deux combattants qu'on est impatient de retrouver face à face pour une revanche ! 
La remise des récompenses a été effectuée par les officiels : Nadine ... et Patrick Blanca, fondateur de l'Académie La Croche, Frédéric Rubio (masqué), expert auprès de la Fédération Internationale des Luttes Associées (FILA) et Jérôme Sanchez (arbitre de la compétition, et entraîneur du club "La Croche - Luttes Olympiques - Plateau Caillou"). 
En attendant les prochaines compétitions, on est assuré que la relève est prête : pour preuve, un vrai pirate de l'Océan Indien ! 
Résultats des Championnats de la Réunion de Croche 2008
- par Jeronimo
le 01/06/2008 @ 17:09 C'est dans la salle "de danse et d'arts martiaux" de la rue la croix à Etang St Paul que les hommes forts de l'île s'étaient donnés rendez-vous en ce dimanche 1er juin. En effet, en provenance de différents clubs et de différentes familles de sports de préhension, les pratiquants de grappling, de sambo, de free fight, de lutte olympique ont osé se défier dans la plus pure tradition réunionnaise. La Croche, liant culture et modernité, a permis à tous ces grands gaillards de s'affronter avec virilité, technicité et respect de l'autre. Les sept catégories de poids comme l'exige la Fédération Internationale des Luttes Asso ciées et le Comité Régional de Lutte ont été l'objet de confrontations courageuses et de qualité. Au delà des résultats, les comportements observés sont le signe d'une volonté de la part d'une grande majorité des combattants Réunionnais de vouloir et pouvoir en découdre sur la base d'un sport de combat "péi", qui semble faire la synthèse de la plupart des pratiques d'opposition au corps à corps. La fête a été particulièrement belle et tous les participants se sont bien jurés de se retrouver le plus tôt possible, la saison prochaine, dans le rond central du tapis de lutte/la croche. Le défi lancé il y a six ans par Patrick Blanca, Jérôme Sanchez et Frédéric Rubio, suite à la publication d'un livre décrivant l'histoire, les techniques, la pédagogie et la codification de cette activité sportive typiquement réunionnaise, est en train de se concrétiser : la croche se positionne culturellement et sportivement comme le creuset où tous les sports de combat de préhension pratiqués à la Réunion peuvent se rassembler, se "REUNIR" pour s'affronter dans le respect de la tradition et des règles d'aujourd'hui. Le pari relevé, restera à confirmer dans les prochaines années, ce désir de vouloir batailler, combattre et lutter à la mode de chez nous. Rendez-vous est donné dès le début de la saison sportive 2008/2009 à tous les combattants de notre département.
Résultats des premiers Championnats de la Réunion de Croche
(lutte traditionnelle de la Réunion) - 1er juin 2008
Les podiums individuels
Catégorie 120 kg
1.. Emmanuel Sénardière (Club de Lutte de Saint-Pierre)
2.. Jean-Pierre Tarley (Lutte Croche Bois de Nèfles)
3.. Alexandre Hoarau (Run Kyokushin Honbu - Sambo)
Catégorie 96 kg
1.. Yves « Charlie » Preira (Club de Lutte de Saint-Pierre)
2.. Lionel Sanchez (Run Kyokushin Honbu - Sambo)
3.. David Fraumens (Club Sportif et Culturel Cité Hyacinthe - Free Fight)
Catégorie 84 kg
1.. Boris Gamel (Run Kyokushin Honbu - Sambo)
2.. Johny Adelin (Club de Lutte Paul Jougla)
3.. Pascal Puylaurent (Fleurimont 1 Top Team)
Catégorie 74 kg
1.. Aurélien Fosse (Club Sportif et Culturel Cité Hyacinthe - Free Fight)
2.. David Vidot (Run Kyokushin Honbu - Sambo)
3.. Brian Imize (Run Kyokushin Honbu - Sambo)
Catégorie 66 kg
1.. Wilfrid Sellaye (Club de Lutte Paul Jougla)
2.. Rafaël Alexandrino (Club Sportif et Culturel Cité Hyacinthe - Free Fight)
3.. Patrice Parmanum (Club de Lutte de Saint-Pierre)
Catégorie 60kg
1.. Tony Verbard (Lutte Croche Bois de Nèfles)
2.. Alexis Bour (Run Kyokushin Honbu - Sambo)
3.. Eddy Philogène (Club Sportif et Culturel Cité Hyacinthe - Free Fight)
Catégorie 55kg
1.. Stéphane Gaudens (Clan K)
Prix spéciaux
Victoire la plus rapide (en 15'') : Emmanuel Sénardière (Club de Lutte de Saint-Pierre), 1er de la catégorie « jusqu'à 120 kg »
Victoire la plus technique (aux points : 14 à 2) : Yves Kerenfort (Clan K), 4ème de la catégorie « jusqu'à 74 kg »
Podium du classement par club
1.. Club de Lutte de Saint-Pierre (2 médailles d'or et 1 médaille de bronze)
2.. Run Kyokushin Honbu - Sambo (1 médaille d'or, 3 d'argent et 2 de bronze)
3.. Club Sportif et Culturel Cité Hyacinthe - Free Fight (1 médaille d'or, 1 d'argent et 2 de bronze)
Lafêt « Lacroche »
- par Lambi le 01/06/2008 @ 17:06 « Ou tire ? », « Mi tire ! » : dimanche, du côté de la commune de St Paul, les crocheurs de l’île vont s’en donner à cœur joie. « Trap' le pie », « cale », « calbuter », « clé malgache », « bat ou main à terre » et « lapé » sont, parmi d’autres, les termes « lontan » qui vont résonner dans le rond central de la salle de combat située au 33, rue la croix à Etang St Paul. Félix, William, Aurélien, Sully, … les gramounes, fort heureusement toujours debout, qui ont fait l’histoire de cette pratique traditionnelle seront présents pour, de leurs propres yeux, constater que la croche n’est pas morte. Au début du siècle passé, les « marmailles » n’avaient pas grand-chose à se mettre sous la dent pour s’amuser et dépenser leur trop plein d’énergie. Pas de télé, pas de foot, livres et ciné réservés aux riches, de plus, des affaires d’hommes devant se régler entre hommes : compte tenu de cela, dans la cour de récréation, à la sortie de l’école, derrière l’église ou près de la plage, les défis s’engageaient une fois la chemise tombée. « Ou tire ? », « Mi tire ! » et spontanément un cercle se formait, un ou deux plus anciens prenaient le statut d’arbitre et les bras s’accrochaient, les jambes s’envolaient, les corps roulaient à terre et immobilisations, étranglements ou ciseaux faisaient crier les spectateurs sentant la fin du combat proche. « Lapé !» prononcée ou la main frappée au sol signifiait qu’un des crocheurs admettait la défaite. Le groupe se resserrait, chacun félicitait son poulain et les deux combattants se séparaient après une franche accolade signifiant quelque part que l’amitié, ou tout du moins le respect, était toujours présent. Aujourd’hui, la pratique a changé. Comme toute activité humaine, il a fallu réactualiser les anciennes techniques, les vieilles règles pour « sportiviser » cette pratique traditionnelle appartenant au patrimoine culturel réunionnais. La codification et les tenues modernes sont censées embellir les projections et autres enchaînements d’actions. Les pratiquants se sont transformés en athlètes à la musculature saillante. La féminisation frappe à la porte tout comme il y a cinquante ans, dans les chemins des charrettes de canne, les jeunes filles n’avaient pas peur de défier leurs frères ou cousins. La Croche, sport du XXI° siècle, voilà qui va faire plaisir à toute une population en quête d’identité et de modernité. Dimanche, les premiers championnats seniors de la Réunion : rendez-vous donc du côté de St Paul où débarquèrent, probablement, les premiers crocheurs réunionnais … LAMBI
Vu sur http://www.aazsport.com/
- par Jeronimo
le 30/05/2008 @ 16:44 LUTTE : Premiers championnats de La Réunion de "Croche" 01.06.08 .  - contact@aazsport.com Categorie: Lutte - Ce dimanche 1er juin de 9h à 18h à l'Etang St Paul se tiendront les premiers Championnats de la Réunion de lutte traditionnelle réunionnaise "La Croche".
La croche est la forme traditionnelle de lutte de La Réunion. Elle est née à La Réunion au 19ème siècle.
Sa réhabilitation a commencé il y a six ans et elle arrive enfin à maturité avec l'organisation de ces championnats. Lieu de compétition Salle de danse et d'arts martiaux
33 rue La Croix
Etang St Paul Catégories de poids 55kg
60kg
66kg
74kg
84kg
96kg
120kg Récompenses Les trois premiers de chaque catégorie recevront une médaille et le champion un diplôme supplémentaire orné du logo du Comité Régional de lutte de La Réunion. http://www.aazsport.com/index.php?id=181&tx_ttnews[tt_news]=1298&tx_ttnews[backPid]=46&cHash=a97b216a78
Championnats de la Réunion de Croche : J-2
- par Jeronimo
le 30/05/2008 @ 16:21 A J-2 des premiers Championnats de la Réunion de Croche, voici quels sont les 40 compétiteurs engagés, issus de 9 clubs différents, tous licenciés au Comité Régional de Lutte de la Réunion. Ils sont répartis par poules de 2, 3 ou 4 combattants, avec des têtes de série (en fonction de leur palmarès en croche), dans les 7 catégories officielles des luttes olympiques. A noter la présence de 10 champions régionaux 2007 ou 2008 de lutte libre, grappling, lutte gréco-romaine, sambo combat et/ou judo, sans oublier 5 vainqueurs des précédents interclubs de croche (généralement tête de série). NB : Les champions régionaux sont surlignés en jaune et les têtes de série sont en caractère gras. Catégorie « jusqu’à 120kg » poule A | poule B | Michel Thazar (117kg) FF | Jean-Pierre Tarley (106kg) BDN | Alexandre Hoarau ( 105kg) RKH | Jimmy Mahé (97kg) RKH | Emmanuel Sénardière (100kg) CLSP | |
Catégorie « jusqu’à 96kg » poule A | poule B | Yves « Charlie » Preira (89kg) CLSP | Jean-Hugo Fayol (95kg) FF | Christophe Boyer (89kg) CLPJ | Johnny Marimoutou (94kg) SE | Faniry Fanomezantsoa (86kg) FF | Lionel Sanchez (93kg) RKH |
Catégorie « jusqu’à 84kg » poule A | poule B | Pascal Puylaurent (84kg) F1TT | Johny Adelin (84kg) CLPJ | Gérard Allouette (82kg) SE | Romain Paumel (82kg) CK | Boris Gamel (81kg) RKH | David Fraumens (80kg) FF |
Catégorie « jusqu’à 74kg » poule A | poule B | Lino Charlettine (73kg) ALC | Jérôme Mussard (74kg) SE | Christian Verlissier (73kg) FF | Willy Serveaux (74kg) FF | Aurélien Fosse (72kg) FF | David Vidot (73kg) RKH | Brian Smize (71kg) RKH | Yves Kerenfort (68kg) CK |
Catégorie « jusqu’à 66kg » poule A | poule B | poule C | Wilfrid Sellaye (66kg) CLPJ | Romain Gamel (65kg) CK | Rafaël Alexandrino (66kg) FF | Redwane Ingar (64kg) CK | Patrice Parmanum (64kg) CLSP | Frédéric Vaxelaire (64kg) CK | Alexis Bour (62kg) RKH | Judickaël Admette (62kg) F1TT | Vincent Germain (64kg) RKH | | | | Josin « Jo » Remanaly (62kg) F1TT |
Catégorie « jusqu’à 60kg » + « jusqu’à 55kg » (un compétiteur surclassé) poule A | poule B | Nabil Timol (60kg) CK | Eddy Philogène (60kg) FF | Tony Verbard (58kg) BDN | Mathieu Bimbard (60kg) CK | Stéphane Gaudins (55kg) CK | |
Abréviations : les clubs en compétition CLSP : Club de Lutte de Saint-Pierre BDN : Lutte Croche Bois de Nèfles FF : Club Sportif et Culturel Cité Hyacinthe - Free Fight RKH : Run Kyokushin Honbu – Sambo CLPJ : Club de Lutte Paul Jougla de Saint-Denis SE : Sambo de l’Est (Saint-André) F1TT : Fleurimont 1 Top Team – Grappling CK : Clan K ALC : Académie La Croche Pronostic : Si les têtes de série tiennent leur place, les clubs favoris sont : | | Or | Argent | Bronze | CLSP | 2 | 1 | | FF | 1 | 2 | | BDN | 1 | 1 | | CLPJ | 1 | 1 | | CK | 1 | | 3 | F1TT | 1 | | 1 | RKH | | 1 | 2 | ALC | | | | SE | | | |
Mais attention, bon nombre de compétiteurs se sont licenciés au Comité Régional de Lutte de la Réunion spécialement pour disputer ces championnats et vont donc faire leurs premiers pas en croche. Il peut y avoir des surprises !
| |
| | |
| Ils soutiennent La Croche | |
|
| |
| | |
|
|
Préférences |
|
|
 251 membres
Connectés :
( personne )
| |
| | |
|
Meilleur combattant |
|
|
A l'approche des Jeux Olympiques 2024 à Paris où lutte, escrime,
boxe, judo et taekwondo seront représentés ...
et pour répondre à
l'éternelle question que se posent les fans de sports de combat et
d'arts martiaux, "Qui est le meilleur combattant de tous les temps ?",
ce livre étudie toutes les périodes historiques, de l'Antiquité jusqu'à
nos jours, toutes les grandes compétitions, tous les sports de combat
majeurs sans armes (sports de préhension, sports de percussion, arts
martiaux mixtes) et avec armes, et donne enfin les classements.
Ce
livre de 800 pages (en e-book ou en 2 tomes) est le résultat de
décennies de collecte d'informations et de recherches
historiques.
Lien
pour se procurer la version numérique e-book (année 2024, 800 pages, 7,99
€ )
Ou les deux tomes en papier, couvertures rigides :
- Tome
1 (année 2024, 461 pages, 33,99€ )
- Tome
2 (année 2024, 348 pages, 28,98 € )
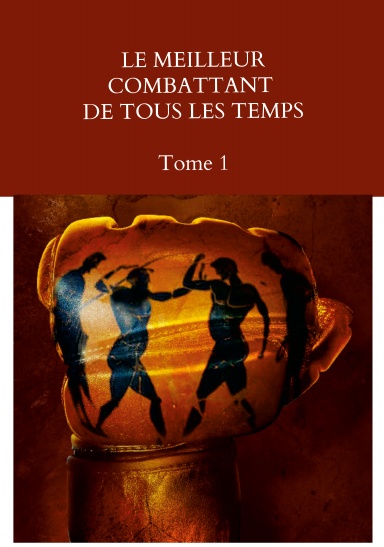 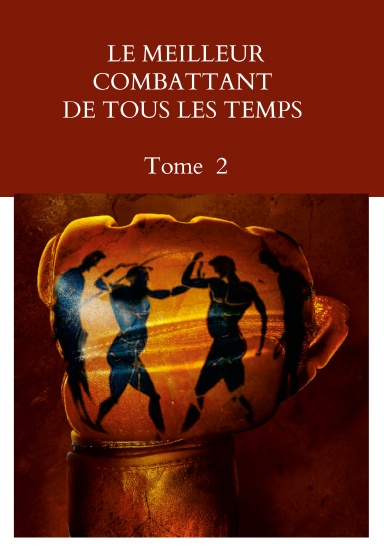 | |
| | |
|